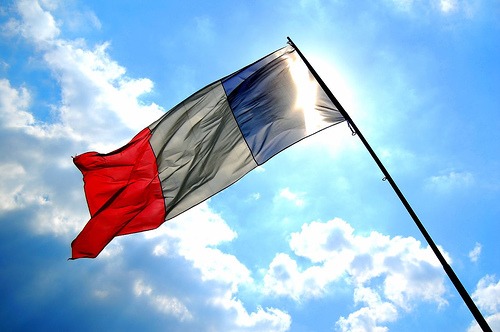Eva Joly a déclenché un beau tollé en proposant de supprimer le défilé militaire du 14 juillet ; et chacun de lui expliquer, à juste titre, que la levée en masse de 1793 symbolisait les idéaux populaires de la Révolution française.
En réalité, il y a bien longtemps (depuis 1918 ? depuis mai 1968 ?) que « mourir pour la patrie » avait cessé d’être considéré par beaucoup comme « le sort le plus beau » : combien de Français – immigrés ou « de souche » – y seraient encore prêts aujourd’hui ?
La suppression de la conscription, en 1997, et le retour à l’ancienne « armée de métier », constitua sans doute, quelles qu’eussent été ses justifications techniques, une terrible erreur politique, mettant fin, par la même occasion, à une des deux grandes « machines à intégrer » de la République ; mais elle n’a fait qu’accentuer une évolution déjà ancienne, dont on mesure l’ampleur en constatant l’incapacité dans laquelle se sont trouvés tous les gouvernements successifs de la remplacer par un service civique général et obligatoire, auquel ils se sont pourtant tous proclamés favorables : le sentiment d’appartenance à une « patrie » semble désormais trop faible à tous les jeunes Français pour qu’on estime possible de leur imposer un tel « sacrifice ».
Certes, il a toujours existé, en France, un vieux fond d’antimilitarisme régulièrement réveillé par des menaces de coups d’Etat contre le régime démocratique (général Boulanger, putschs de 1958 ou de 1962), ou des comportements d’une grande partie des militaires lors de l’affaire Dreyfus, de la collaboration sous le gouvernement Pétain ou des guerres coloniales (qui leur furent imposées par des gouvernements souvent « de gauche ») ; mais tout ceci n’avait jamais réussi à ébranler profondément le sentiment de « l’armée au service de la Nation » et la conscience de l’impossibilité de toute politique d’indépendance nationale sans une force militaire efficace : pour y parvenir, il a fallu que le sentiment lui-même d’appartenir à une Nation commençât à se diluer.
Aujourd’hui, il ne semble plus subsister du sentiment patriotique que ses symboles (le drapeau, la Marseillaise) et le chauvinisme sportif, notamment footballistique, milieu dont on a voulu faire un peu trop rapidement l’image de « la France blanc-black-beur » alors que c’est sans doute celui où le racisme le plus primaire s’exprime de la façon la plus ouvertement assumée. Il ne s’agit là, bien entendu, que l’un des effets de la mondialisation, machine à disloquer toutes les solidarités nationales et sociales, et à renvoyer l’individu désormais isolé à ses liens communautaristes, ethniques, régionalistes ou religieux, d’autant plus violents qu’en grande partie artificiels.
Et pourtant, ce serait une grande erreur que de croire que patriotisme et mondialisation de l’économie sont incompatibles, alors que c’est exactement l’inverse ; le monde est aujourd’hui livré à l’affrontement sans merci d’un petit nombre de grands blocs économiques, chacun tirant ses forces d’un véritable chauvinisme, comme on peut le constater en Chine ou aux Etats-Unis ; et c’est le grand handicap de l’Union Européenne que d’en être dépourvue. Mais pouvait-il en être autrement ?
Le patriotisme ne peut découler que du sentiment d’appartenance à un même peuple, qui ne peut se décréter dans des traités élaborés autour d’une table de négociations ; on peut le déplorer, mais il n’existe pas aujourd’hui de « peuple européen » : quel sentiment possible de communauté de passés et de destins entre les Suédois et les Siciliens, alors que ces derniers ne sont même pas considérés comme leurs compatriotes par les Italiens de la Ligue du Nord ? Sans même raconter ici des histoires belges…
Victimes du projet européen inconsciemment marxiste Nous sommes aujourd’hui victimes du projet européen inconsciemment marxiste (ce seraient les infrastructures économiques qui engendreraient les superstructures idéologiques) de Jean Monnet, fondé sur l’idée qu’un sentiment national découlerait automatiquement d’une union économique et monétaire, et qu’il accoucherait inévitablement d’une union politique, alors que jamais la fameuse boutade de Henry Kissinger « l’Europe, quel numéro de téléphone ? » n’a été aussi vraie : celui de Monsieur Barroso ? de Monsieur Van Rampouy ? du chef de l’Etat exerçant la présidence tournante du moment ?
Le seul intérêt d’avoir fait ratifier le traité de Lisbonne (par les Parlements, faute d’avoir pu le faire par les peuples) est d’avoir démontré par l’absurde l’inanité des processus de décision politique qu’il avait voulu mettre en place, et qui ne fonctionnent bien que lorsqu’il n’y a rien à décider ; mais, devant tout véritable problème, comme celui de la crise dans laquelle nous vivons depuis 2008, ce sont évidemment les chefs d’Etat qui, seuls, peuvent prendre la main.
On imagine mal la Chine, le Japon ou les Etats-Unis renoncer à leur patriotisme national, comme y sont invités les pays de l’Union Européenne ; et il n’est pas étonnant que les Etats-Unis aient tellement poussé à l’élargissement de l’Union Européenne, y inclus jusqu’à la Turquie, avec pour seul but, dans cette guerre qu’est la mondialisation, de réduire à l’impuissance un adversaire en le disloquant sous prétexte de l’unifier, alors qu’eux-mêmes se gardent bien, dans la zone de libre-échange qu’ils ont constituée avec d’autres pays du continent américain (l’ALENA), de déléguer la moindre parcelle de leur souveraineté politique ou monétaire à une quelconque instance supranationale ; la société américaine a été souvent comparée, par ses théoriciens, à une mosaïque qui ne faisait sens que parce que ses différents fragments étaient tenus en place par le ciment qu’était le patriotisme ; en renonçant au sien, la France cessera un jour de faire sens.
Elie Arié
Journaliste à Marianne